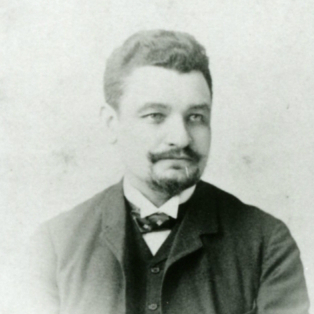Voici le quatrième portrait d’un mauvais prédicateur, extrait du traité
« Comment il ne faut pas prêcher » de Napoléon Roussel (1857). Il s’agit de Placide. Méfiant à égard de la raison, ce prédicateur s’arrête à la lettre du texte biblique. Ses sermons sont de longs enchaînements de passages bibliques dont le seul élément de liaison est l’association de mots-clé.
« … ses citations ne se lient ni par le sens, ni par la tendance, mais par les mots. Ce sont des bouts de fil de toutes couleurs, longueur et grosseur, ajoutés les uns aux autres, et déroulés pendant une demi-heure ; fils de soie et d’or, sans doute, mais fils qui, noués de la sorte , perdent presque toute leur valeur ; un passage en chasse un autre, et le seul qui vous reste est toujours le dernier. »
Roussel donne un exemple savoureux d’un tel enchaînement de phrases :
« Nous méditerons ensemble, dit Placide, ces paroles de l’Evangile selon saint Mathieu : « J’ai retiré mon fils d’EGYPTE. » Mes frères, l’EGYPTE, c’est le monde, c’est BABYLONE, selon qu’il est dit dans l’Apocalypse : la ville qui s’appelle spirituellement Sodome et Egypte, où même NOTRE SEIGNEUR a été crucifié ; car, comme le dit saint Paul aux Corinthiens, NOTRE SEIGNEUR a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre JUSTIFICATION ; et vous savez qu’ailleurs le même apôtre a dit : « Personne ne sera JUSTIFIE par les œuvres de la LOI. » En effet, la LOI donne la connaissance du PECHE, et le salaire du PECHE, c’est la MORT, la MORT ETERNELLE ; car il y a une MORT ETERNELLE comme il y a une VIE ETERNELLE. Selon cette déclaration, les uns iront à la VIE ETERNELLE et les autres au feu éternel, le feu dont il est dit qu’il ne s’éteint point et le VER, qui ne meurt point ; le VER qui ne meurt point, c’est le serpent, c’est SATAN, et SATAN signifie calomniateur, MENTEUR ; sans doute parce que le serpent à MENTI à Eve en lui disant : « Vous ne mourrez point, mais vous serez semblables à des Dieux. »
Bien entendu, vu que le prédicateur saute du coq à l’âne, sans avoir idée précise d’où il veut en venir, l’auditeur a du mal à suivre. Le discours s’arrête, non pas quand le sujet est traité, mais quand le temps imparti s’est écoulé.
Si les paroles de Placide sont bibliques, son style ne l’est pas, car les auteurs bibliques puisent leurs mots, leurs images, leur langage dans le contexte de leur époque ; ils « se servent des objets qui sont sous les yeux, sous les mains de leurs auditeurs ; et l’on peut supposer que d’après la même règle, Jésus, les prophètes et les apôtres, s’adressant aux Français ou aux Chinois de nos jours, leur eussent parlé d’opium et de chemins de fer. » Du coup, tisser un sermon d’aujourd’hui avec les mots et les images d’autrefois, c’est faire le contraire de ce qu’ils ont fait, « c’est conserver leur lettre morte et tuer leur esprit, c’est ajouter la difficulté de saisir la figure inconnue à la difficulté de comprendre l’objet figuré, et ainsi c’est donner des idées fausses ou rebuter les auditeurs ».
Roussel conseille de ne pas trop citer la Bible, mais de dire les choses en bon français, dans un style populaire et moderne, et d’insérer, de temps en temps, un mot biblique, qui du coup se trouve valorisé. Un trop plein de citations a l’effet contraire.
L’auteur estime que l’absence de méthode chez Placide a pour origine sa paresse intellectuelle ; le fait d’enfiler des phrases toutes faites permet de passer pour profond auprès de ceux qui ne comprennent pas ce langage, et de créer une impression de piété.
Placide risque d’ennuyer ses auditeurs, et ce qui est bien plus grave encore, de détourner les gens de l’Evangile. Roussel conclut :
« C’est bien assez que la sagesse de Dieu paraisse une folie à l’homme naturel, sans aller lui donner un aspect étrange ; et vous feriez bien mieux de vous donner un peu de peine pour la faire comprendre en style simple, dans ce style dont vous et tout le monde vous servez tous les jours ! »
Egalement publié sur mon site consacré à Adolphe Monod (ici).